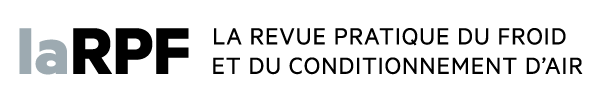Pixabay
Pixabay Jeux Olympiques : la neige de culture, pas canon ?Il faudra attendre les Jeux olympiques de Calgary (Canada) en 1988 pour assister à la première utilisation de canons à neige dans un contexte de compétition olympique. Plus de vingt ans après, les jeux de Pékin (Chine) sont sous le feu des critiques pour une empreinte écologique énorme. Quasiment 100 ...
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous