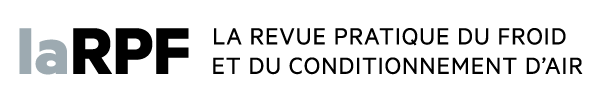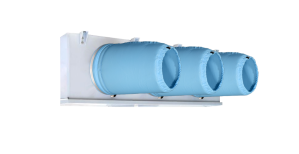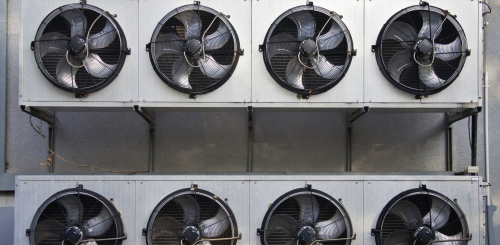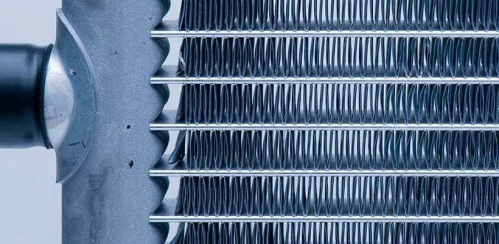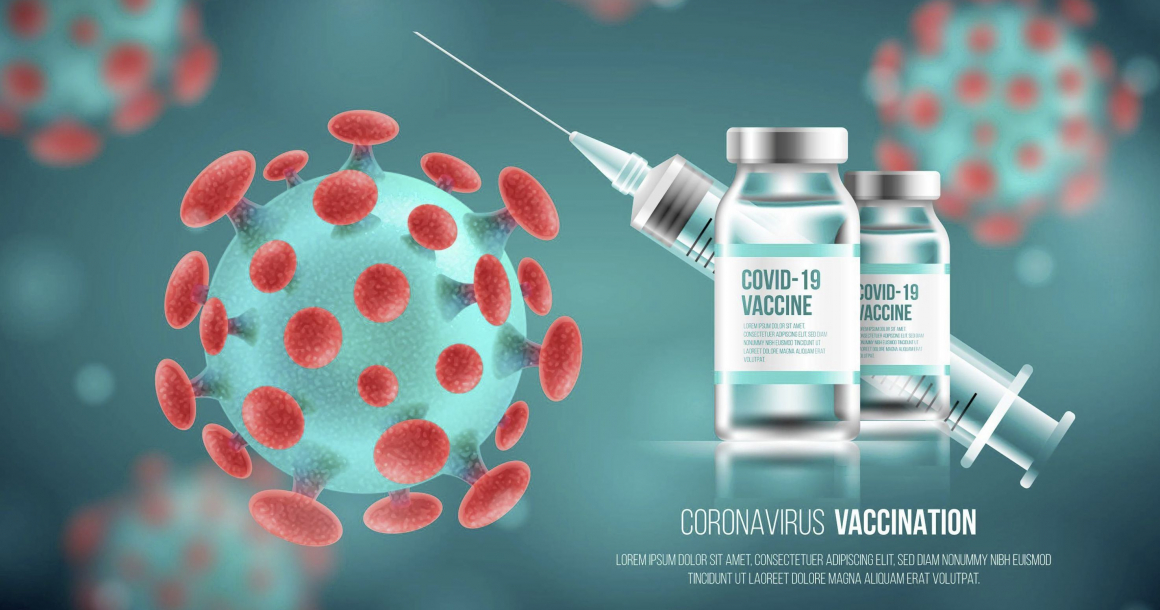 Pikisuperstar
Pikisuperstar
Cet article a pour objectif de passer en revue d’une manière pratique ce qui est aujourd’hui possible pour garantir la chaîne du froid cryogénique des vaccins Covid 19 lors de leurs transports sur des circuits longs et/ou des circuits courts.
Nous évoquerons tout d’abord les spécificités des vaccins à base de mRNA par rapport à une fabrication classique et ensuite les conditions sine qua none pour garantir leur immunogénicité dans le temps et l’intérêt d’une chaîne de froid irréprochable. 1- Spécificité du vaccin Covid à base de mARN Le vaccin à base d’ARN messager e...
Cet article est réservé aux
abonnés
Continuez votre lecture en créant votre compte et profitez de 5 articles gratuits
Pour lire tous les articles en illimité, abonnez-vous